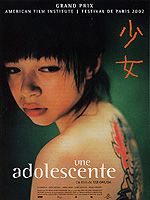|
Dur, dur, les années estudiantines lorsque l’on est jeune, beau et riche… Les soirées à thème, la coke à haut débit, la baise constante… Ca use à force. Heureusement qu’il y a les heures de cours pour pioncer et les diplômes pour se moucher dedans, sinon on imagine mal comment ferait Sean Bateman pour s’en remettre… Ha oui il y a Lauren, qui l’obsède gentiment. Lauren et ses enveloppes violettes qu’elle dépose quotidiennement… des pages pleines d’idées sensuelles et de passions inavouées que Sean dévore des yeux, avant d’y consacrer d’autres activités corporelles… Lauren qui n’est pas comme les autres, Lauren qui est pure, vierge, fraîche et insondable. Rien à voir avec la blonde aux yeux verrons dont Sean ne se rappelle même pas le nom, qu’il a sauté lors de la soirée «mouillée » et qu’il s’enverrait bien une nouvelle fois le temps de l’attente d’un geste, d’une attention de son inaccessible muse. L’énergie que Sean développe à l’égard des écrits de Lauren succite bien des sentiments de la part de Paul qui aimerait bien s’attribuer cet élan passionnel. Paul est homo, ne s’en cache pas et c’est Sean qui le botte. Paul fantasme, Paul accoste, Paul y croit. Il tripote du footballeur de fac, guettant l’instant ou Sean s’abandonnera à ses avances non-dissimulées… Victor lui est en europe. Lauren a sa photo sur sa table de chevet. Laura est la colloc de chambrée de Lauren, et se repoudre le nez (snif) avant de sortir… Les autres on s’en fout, de toutes façons « personne ne connaît personne » . Super.
La trame, les protagonistes, la fac, la superficialité du propos scolaire, tout ça fleure bon la série télé d’ado, Berverly Hills et Dawson en tête de liste. On sait nos amis d’outre-atlantique férus, voire obsédés des histoires d’universités, à croire qu’il s’y passe quelque chose. Pourtant au vu des différents épisodes des séries précitées, on ne peut que constater l’affligeant vide qui habitent les écoles américaines : jamais en cours, les Kevin, Cindy, Brandon, Skipper, et Kelly, sont constamment ailleurs (dans un couloir, devant un vestiaire, sur une pelouse, à la cantoche) à se raconter qu’ils aimeraient bien se lécher la pomme. Depuis longtemps donc, la télévision aime nous raconter qu’un cursus scolaire c’est avant tout l’école de la vie, et que si on n'y pécho pas de la gazelle à tour de bras, on rate là une occasion irrattrapable de débrider son éducation sentimentale, voire sexuelle. Roger Avary via son adaptation du roman de Bret Easton Ellis prolonge les grandes lignes du genre, en imaginant le coté obscur de cette dégénérescence passive, extrapolant dans la débauche des soirées universitaires, cet objectif extra-scolaire de tirer sa crampe.
Ca aurait pu donner quelque chose d'assez drôle si la réalisation ne s'était pas encroûtée dans tout ce qui se fait de pire dans l'ado-soap. Sûrement soucieux de coller au genre (la présence d'acteurs de série l'atteste), Avary plombe son film de dialogues super creux voire carrément cons, d'une intrigue à deux balles, d'une narration générale navrante, le tout filmé sans profondeur, ni de fond, ni de champs, sur une pellicule parfaitement lisse. Otez les deux seules scènes réussies du film (scène de rencontre un samedi matin entre Sean et Lauren et scène de transhumance de Victor), il ne reste qu'un vase creux. Justifier cette absence de relief sur l'unique volonté d'illustrer la superficialité fait pitié. A ce titre, on prend bel et bien deux coups de massue à la fin du film lorsque d'une part le personnage Sean Bateman, absorbé comme jamais, prononce cette réplique minable de forme et de sens "personne ne connaît personne" , et d'autre part lorsque l'on réalise que l'intrigue se conclue ainsi, sur un couac pseudo-philosophique que même un Jean-Claude Van Damme ne se hasarderait pas à prononcer de peur de paraître ridicule.
Sur le papier, le principe de ramener l'univers de Bret Easton Ellis à l'imagerie hypocrite des séries télé, avait pourtant de quoi séduire. Or le résultat est assez mou, comme si les deux extrêmes étaient peu consentants à l'union. Hormis un plan assez franc de taillades de veines, Avary assume peu à l'image la débauche décrite dans le texte : la coke se sniffe toujours hors champs, les jeunes copulent sapés et en plan serré, la masturbation se fait derrière un coussin ou de dos, et les homos dansent sur du Wham en boxer Dim. Pas une fesse en vue, pas de poil non plus, pas de pelles baveuses ni même de baisers mouillés. Certaines situations sont suggérées avec autant d'inspiration qu'un American Pie, et la comparaison, pourtant peu flatteuse, vient aisément à l'esprit. C'est un peu la honte. Lorsque l'on se rappelle que le texte de départ vient de l'écrivain d'American Psycho et que son adaptation est signée de l'auteur de Killing Zoé, on ne peut qu'être amer devant ce constat.
Enzo
|